Ces soldats israéliens qui regrettent d’avoir semé la terreur

Article d’Isabelle Alexandrine Bourgeois pour Essentiel News, journaliste et fondatrice du Média en ligne Planète Vagabonde
Partager les témoignages de soldats israéliens repentis a pour but de vouloir remettre modestement de l’équilibre dans le compte rendu de l’actualité. Il ne s’agit pas de rajouter de l’huile sur le feu, mais plutôt de soutenir l’équanimité dans le traitement de l’information et le partage de récits douloureux et positifs. Dans toute situation conflictuelle, seule la reconnaissance mutuelle des atrocités commises pourra ouvrir une brèche vers la paix. Et le courageux mea culpa de certains soldats israéliens va dans ce sens.
Pour des raisons idéologiques, les récits de victimes israéliennes et plus largement juives, inondent la presse depuis des décennies, réduisant le rôle généralisé des Palestiniens à celui de terroristes, ou plus moindrement, d’«animaux». L’Histoire est complexe et l’objectif de cet article n’est pas de la réécrire. Cependant, il est de notre devoir, en qualité d’humains et de journalistes, de ne plus contribuer, par ignorance, consentement ou passivité, à pérenniser cette discrimination médiatique, d’autant plus que le revirement vaillant de jeunes militaires israéliens est une actualité qui mérite d’être mise en lumière. Voici un premier témoignage d’un soldat israélien qui regrette ses actions passées:
Les repentis : un premier pas vers le pardon ?
En plus de ces militaires qui ont le courage de faire leur examen de conscience, il existe d’autres témoignages de jeunes Israéliens qui ont refusé de servir dans les Territoires occupés pour des raisons morales, éthiques ou politiques. Ces soldats ont expliqué leur décision à travers des lettres, des déclarations publiques et des interviews. En 2003, un groupe de 27 pilotes de l’armée de l’air israélienne a signé une lettre déclarant qu’ils refusaient de participer à des missions de bombardement dans les Territoires occupés. Ils ont expliqué que ces missions causaient des dommages collatéraux importants, y compris la mort de civils innocents, et qu’ils ne voulaient pas être impliqués dans des actions qu’ils considéraient comme immorales et contraires aux valeurs humanitaires.
En 2002, un groupe de soldats et d’officiers réservistes a publié une lettre connue sous le nom de « Lettre des Combattants« . Ils ont déclaré qu’ils refusaient de servir dans les Territoires occupés parce qu’ils croyaient que l’occupation était une source de souffrance pour les Palestiniens et qu’elle corrompait la société israélienne. Ils ont également exprimé leur opposition à la politique de leur gouvernement, qu’ils considéraient comme oppressive et violente. Des organisations comme Breaking the Silence et des médias comme BBC et The New York Times ont couvert cette initiative.
Avner Wishnitzer, un ancien soldat de l’unité d’élite Sayeret Matkal, a expliqué dernièrement son refus de servir dans les Territoires occupés en disant qu’il ne pouvait pas justifier la violence et l’oppression exercées contre les Palestiniens. Il a décrit comment son expérience sur le terrain l’a conduit à remettre en question les ordres qu’il recevait et à prendre la décision de ne plus participer à des actions qu’il considérait comme injustes. Son action militante se concentre sur la dénonciation des politiques israéliennes dans les Territoires palestiniens, qu’il considère comme immorales et contraires aux valeurs humanitaires. Il a partagé son témoignage publiquement pour sensibiliser à la violence et aux abus qu’il a observés, et il soutient des initiatives visant à promouvoir la paix et les droits de l’homme. Wishnitzer incarne le mouvement des « refuseniks », ces soldats israéliens qui refusent de participer à des actions qu’ils jugent injustes ou oppressives.

Les réservistes Max Kresch et Michael Ofer-Ziv, après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, ont initialement répondu à l’appel à la mobilisation. Cependant, confrontés à ce qu’ils percevaient comme une vengeance aveugle et une négligence des vies palestiniennes, ils ont décidé de ne plus servir sous le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Ils ont signé une lettre, avec d’autres réservistes, refusant de continuer à servir tant qu’un accord de cessez-le-feu pour la libération des otages israéliens à Gaza ne serait pas conclu.
Benzi Sanders : d’ancien soldat israélien à militant pour la paix
Benzi Sanders fait partie de ces voix qui émergent de l’intérieur même du système militaire israélien pour en dénoncer les dérives. Ancien soldat de l’armée israélienne (IDF), il est aujourd’hui un fervent militant des droits humains et un opposant à l’occupation des territoires palestiniens. Né dans une famille juive orthodoxe à New York, il décide d’émigrer en Israël et de rejoindre les rangs de l’armée, où il sert notamment lors de l’opération Bordure Protectrice en 2014, une offensive militaire contre Gaza. Mais très vite, son expérience sur le terrain l’amène à remettre en question la réalité des ordres reçus. On lui avait assuré que tous les civils avaient fui les zones de combat, mais ce qu’il voit ne correspond pas toujours à ce qu’on lui dit.
Marqué par cette expérience, il choisit de briser le silence. Il rejoint l’ONG Breaking the Silence, une organisation composée d’anciens soldats israéliens témoignant publiquement des réalités de l’occupation. À travers des conférences et des interventions médiatiques, il dénonce des exactions militaires et alerte sur l’impact des politiques israéliennes, notamment leur effet contre-productif sur la montée en puissance du Hamas. Aujourd’hui, Benzi Sanders incarne cette génération d’Israéliens qui refusent de détourner le regard et qui plaident pour une solution pacifique et équitable au conflit israélo-palestinien. Un engagement qui, dans un contexte toujours plus polarisé, résonne comme un appel à la conscience collective.
Breaking the Silence
Yehuda Shaul, un ancien soldat qui a servi dans les Territoires occupés, a fondé l’organisation Breaking the Silence (Shovrim Shtika) après son service militaire. Cette organisation recueille et publie les témoignages de soldats israéliens sur leurs expériences dans les Territoires occupés. Shaul a expliqué que son refus de continuer à servir était motivé par le désir de dénoncer les abus et les violations des droits de l’homme qu’il avait constatés. L’organisation a réussi à briser un tabou en Israël en encourageant des discussions ouvertes sur les actions de l’armée dans les Territoires occupés. Ses témoignages, souvent poignants et détaillés, ont permis à de nombreux Israéliens de prendre conscience des réalités de l’occupation, qu’ils ignoraient ou préféraient ignorer. Ces récits ont alimenté des débats publics sur les implications morales, éthiques et politiques de l’occupation, notamment dans les médias, les universités et les cercles politiques.
Breaking the silence mène des activités éducatives, notamment des visites guidées dans les Territoires occupés pour des groupes d’étudiants, d’enseignants et de citoyens israéliens. Ces initiatives visent à montrer les réalités sur le terrain et à encourager une réflexion critique. Ces efforts ont touché de jeunes Israéliens, certains d’entre eux remettant en question leur service militaire ou s’engageant dans des mouvements pour la paix et les droits de l’homme. Évidemment, l’organisation a été la cible de campagnes de dénigrement de la part de certains politiciens et institutions israéliennes qui l’ont qualifiée de « traitre » ou « anti-israélienne » par des figures politiques qui ont restreint son accès à certaines écoles et institutions publiques. Malgré ces attaques, l’organisation continue de fonctionner, bénéficiant du soutien de donateurs internationaux et de militants locaux.
L’approche de Breaking the Silence ressemble à la célèbre Commission de la vérité et de la réconciliation (CVR) en Afrique du Sud, une expérience de justice restaurative présidée par Mgr Desmond Tutu. Se déroulant d’avril 1996 à octobre 1998, son but principal était de recenser toutes les violations des droits de l’homme commises depuis le massacre de Sharpeville en 1960, en pleine apogée de la politique d’apartheid initiée en 1948 par le gouvernement sud-africain, afin de permettre une réconciliation nationale entre les victimes et les auteurs d’exactions, par la reconnaissance et le pardon mutuels des souffrances. Même si ce processus est loin d’être achevé, il n’empêche qu’il a déjà permis d’engager des poursuites contre un certain nombre de personnes impliquées dans les violations des droits humains commises sous l’apartheid.
Quand la paix se construit par le film-documentaire
Si la violence et les divisions marquent trop souvent l’actualité israélo-palestinienne, des initiatives citoyennes témoignent d’une volonté de dialogue et de réconciliation. Le documentaire « No Other Land », réalisé en 2024 par un collectif palestino-israélien, en est une illustration vibrante. Ce film suit le destin de Basel Adra, un jeune activiste palestinien originaire de Masafer Yatta, une région du sud de la Cisjordanie où les villages palestiniens subissent des démolitions systématiques par l’armée israélienne. Depuis son enfance, il documente avec courage la lente disparition de sa communauté. Mais au-delà du constat amer, « No Other Land » ouvre une brèche d’espoir : au fil du tournage, Basel croise la route de Yuval Abraham, un journaliste israélien. Contre toute attente, une amitié sincère naît entre eux, transcendant les frontières et révélant une humanité commune plus forte que les lignes de séparation.
Le film met en exergue les contrastes saisissants entre leurs conditions de vie respectives, tout en soulignant la possibilité, bien que fragile, d’un dialogue basé sur la reconnaissance et la justice. Présenté en première mondiale au 74e Festival international du film de Berlin en février 2024, « No Other Land » a été couronné par le Prix du public Panorama du meilleur film documentaire ainsi que le Berlinale Documentary Award. En janvier 2025, il a franchi un nouveau cap en étant nommé pour l’Oscar du meilleur long métrage documentaire.
Dans un contexte marqué par l’incompréhension et l’opposition, ce film offre une vision lumineuse d’un possible avenir où la solidarité dépasse les antagonismes, où la reconnaissance mutuelle devient un moteur de changement. « No Other Land » n’est pas seulement un témoignage, c’est un appel vibrant à croire en la puissance des rencontres et du dialogue, même dans les territoires les plus fracturés.
« Tantura » : Une enquête cinématographique sur une mémoire enfouie
Plus largement, dans l’histoire tourmentée du conflit israélo-palestinien, certains épisodes restent dans l’ombre, dissimulés derrière les récits officiels. « Tantura », documentaire réalisé par Alon Schwarz en 2022, lève le voile sur l’un d’eux : le massacre présumé du village palestinien éponyme en mai 1948.
À travers une exploration minutieuse, le film exhume les souvenirs douloureux des témoins et confronte les silences d’anciens soldats israéliens. Le village de Tantura, situé sur la côte méditerranéenne, fut le théâtre d’une tragédie longtemps contestée. Après sa reddition lors de la guerre israélo-arabe de 1948, des soldats de la brigade Alexandroni de la Haganah auraient exécuté un nombre indéterminé de villageois palestiniens – certains parlent de dizaines de morts, d’autres évoquent plus de 200 victimes. Le documentaire s’appuie sur les travaux de Teddy Katz, un étudiant de l’Université de Haïfa qui, à la fin des années 1990, entreprit un travail colossal : 140 heures d’enregistrements, 135 témoignages, une plongée sans précédent dans l’histoire orale du drame. Pourtant, son étude, initialement reconnue, fut plus tard invalidée sous la pression de l’establishment israélien, et son auteur réduit au silence.
Avec une caméra attentive et sans complaisance, Alon Schwarz relance cette enquête troublante. Il confronte d’anciens soldats à leurs propres paroles, enregistrées des décennies plus tôt, et recueille les récits des survivants palestiniens. Entre malaise, déni et confessions à demi-mots, « Tantura » questionne la manière dont une nation façonne son passé et choisit ses oublis. Présenté au Festival du film de Sundance en 2022, le film n’a pas seulement suscité la controverse : il a réveillé des mémoires, rouvert des plaies et rappelé que la vérité, aussi insaisissable soit-elle, finit toujours par refaire surface. Un documentaire qui, plus qu’un réquisitoire, s’impose comme un miroir tendu à l’histoire et à la conscience collective.
En résumé, la reconnaissance des atrocités passées est un élément essentiel de toute réconciliation. Le pardon mutuel ne peut exister sans une prise de responsabilité collective, et chaque processus de paix repose sur un équilibre délicat entre mémoire, justice et espoir de reconstruction. Si ces démarches ne guérissent pas immédiatement les blessures du passé, elles permettent d’amorcer un dialogue et d’éviter que l’histoire ne se répète. Et elle se répétera, si chaque humain ne s’engage pas à titre individuel dans des recherches profondes, en soi et à l’extérieur, sur les maux qui rongent notre monde. En attendant, chapeau bas à ces héros ordinaires extraordinaires qui, à leur échelle, petit pas par petit pas, changent le cours de l’Histoire.
Et à son niveau aussi, Essentiel News se fait un point d’honneur à mettre en lumière la beauté où elle se tapit, même dans les plus petits recoins en l’Homme.
🎁 Jusqu’au 31 décembre, faites un don et participez à nos rencontres privilégiées. Nous vous offrons aussi des livres, sélectionnés parmi 18 auteurs engagés 📚.
A découvrir ici: https://essentiel.news/dons/
Résidents en Suisse: vos dons sont déductibles de vos impôts.
Un immense MERCI à tous nos donateurs 🫶
Pensez à vous abonner ou à faire un don.
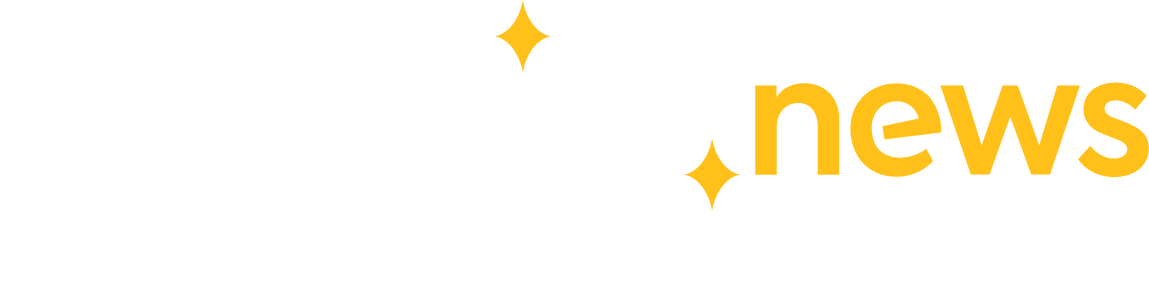
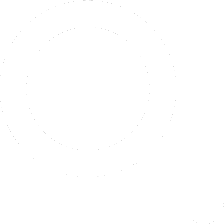
Merci pour cet article, ce reportage très intéressant. Il y a environ dix ans, j’ai vu un documentaire franco-israélien fait par une journaliste, dont j’ai oublié le nom, pardon, sur le sort de Rachel Corrie, jeune américaine qui est morte dans une opération de paix dans les territoires, écrasée par un tank, je crois, parce qu’elle refusait de décamper d’un endroit où on démolissait. Elle est devenue une martyr pour les Palestiniens.
Il est bon de savoir que nous ne pouvons pas mettre tous les Israéliens, tous les Palestiniens dans UN MEME CAMP, par exemple, pour parler de la situation. En soi, c’est très précieux.
Et il est bon, il serait bon de montrer des exemples où le pardon est à l’oeuvre, encore que je ne suis pas certaine du tout de ce qui permet le pardon, qui est une affaire de sujet, de personnes, et non pas d’états. Si nous montrons pas d’exemples de personnes ayant pardonné, comment d’autres peuvent-ils imaginer que c’est possible ?…
3 larmes et c’est reparti pour un tour. À d’autres!
On reconnaît tout de suite les sionistes, c’est pas difficile: Ils ne parlent presque jamais de justice et quand ils le font, c’est soit celle de la saint Glinglin de l’apocalypse, soit ils s’en fichent, la combattent ou la traitent d’antisémite. Ceci car derrière leurs apparentes divisions, cette bande de colonialistes, donc de squatters suprématistes sans vergogne et sans morale, sont tous bien d’accord sur le fond: La terre est leur, et dans ce contexte, ils ont toujours su que la justice est le droit fondamental qui conditionne tous les autres droits des Palestiniens.
Il ne faut pas rêver, la seule alternative à la justice qui peut permettre d’apporter la paix, ceci surtout compte tenu de l’accumulation des crimes depuis même avant la Nakba de 1948, c’est qu’un des deux peuples qui se disputent la terre des Palestiniens se débarrasse de l’autre. Vu cette accumulation continue et insensée des crimes pendant des décennies, je suis pour une justice à la rwandaise: celui qui n’a tué que 2 ou 3 civils adultes, on le condamne à une peine pas trop lourde. par contre ceux qui en ont tué plus ou qui s’en sont pris à des enfants voir même des bébés, c’est qu’ils sont irrécupérables pour pouvoir commettre des saloperies pareilles et on va pas perdre plus d’énergie, de temps et d’argent avec eux: les seuls traitements qui leur conviennent c’est comme à Nuremberg la corde, ou comme en tant de guerre le peloton d’exécution.
De la rivière à la mer, ici, pareils et maintenant: Justice pour tous et pour tous les peuples.!!!
De la rivière à la mer, ici, partout et maintenant: Justice pour tous et pour tous les peuples.!!!