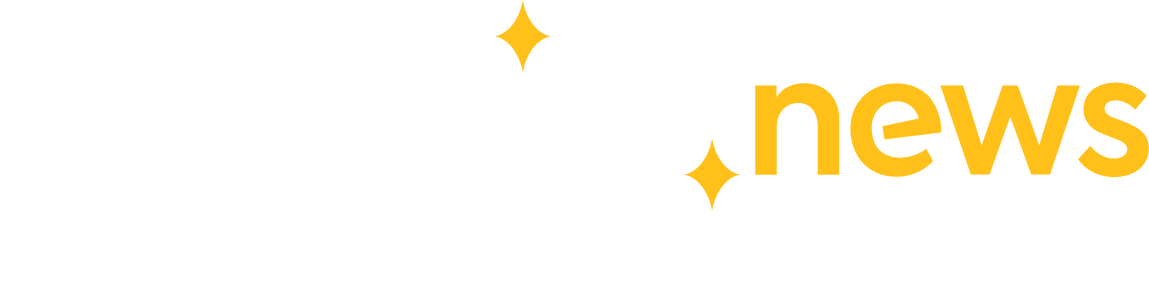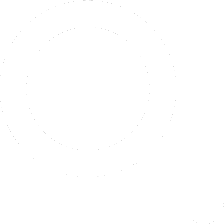Partenariats hautes écoles et entreprises : une alliance controversée

Article d’Isabelle A. Bourgeois pour Essentiel News, journaliste, fondatrice du média Planète Vagabonde
L’ Albert School, une haute école fondée en 2022 à Paris, s’apprête à ouvrir un nouveau campus à Genève en septembre 2025. Elle affiche une ambition claire : proposer une éducation de pointe centrée sur l’analyse de données et son application en entreprise. Elle se présente comme un vivier de l’excellence où se forgent les leaders de demain. Mais pour étayer ce prestige, l’école utilise la réussite financière de ses bailleurs de fonds, de surcroît, au parcours contrasté. Quel rapport avec l’excellence ?
En formant des jeunes spécialistes de la data et du business, Albert School alimente directement des secteurs clés comme la tech, la e-santé et la finance, où plusieurs investisseurs de ces écoles réalisent leurs profits. D’un côté, on peut se réjouir que des grands patrons d’entreprises participent au déploiement des idées, de l’innovation et de la vie économique. En orientant les programmes éducatifs au profit de leurs propres intérêts économiques, on peut parler d’un modèle « gagnant-gagnant » où tout le monde y trouve son compte, les étudiants comme les investisseurs. La réflexion pourrait s’arrêter ici et tout le monde est content.
«Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais»
Or, on peut s’interroger sur la cohérence entre le message publicitaire de l’Albert School et le parcours de ses investisseurs. Sur son site internet, la promesse est alléchante:
«Albert School est soutenue par des leaders de l’industrie tels que Bernard Arnault et Xavier Niel, ce qui témoigne de notre excellence et de notre crédibilité dans le domaine de l’enseignement du business et de la data.» Vraiment?
L’école n’hésite pas à mettre en avant ses investisseurs comme preuve de son sérieux et de sa légitimité. Mais de quelle crédibilité s’agit-il ? Est-ce que la crédibilité d’une école doit se limiter à la réussite financière de ses bailleurs de fonds, quelque soit leur parcours personnel controversé ? Et en quoi Xavier Niel, Bernard Arnault, Rodolphe Saadé, Ariane de Rothschild, Christophe Bancel et Marc Simoncini sont-ils crédibles dans les datas sciences ? Aucun d’entre eux n’est expert en analyse de données au sens académique du terme. Ils n’ont ni formation scientifique avancée en analyse de données, ni parcours de chercheurs en intelligence artificielle ou en statistiques avancées.
Leur lien avec ce domaine repose davantage sur l’exploitation des données à des fins commerciales, financières et industrielles que sur une véritable expertise technique. Ils représentent de grandes fortunes, ou des réseaux à la réputation sulfureuse. En effet, un examen attentif de certains de leurs parcours dévoile des affaires judiciaires, des scandales financiers et des pratiques pour le moins contestables qu’ils cherchent à minimiser par la posture du milliardaire qui a « réussi ».
Derrière la vitrine rutilante…

Xavier Niel, présenté comme un entrepreneur autodidacte ayant révolutionné les télécommunications avec Free, traîne un lourd passé judiciaire. Pilier du capitalisme numérique, il est aussi un acteur-clé du paysage médiatique, un proche de Brigitte et Emmanuel Macron et le gendre de Bernard Arnault. En 2004, il est mis en examen et placé en détention provisoire pour proxénétisme aggravé et recel d’abus de biens sociaux. Plus tard, il est condamné à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 250 000 euros pour recel d’abus de biens sociaux.
Dans les années 1980, Xavier Niel s’était lancé dans les services de Minitel rose, ce qui lui a permis de constituer une fortune personnelle dès l’âge de 24 ans. Le Minitel rose de Niel n’était pas qu’un simple service de rencontres pour adultes. Il était structuré autour de l’exploitation des fantasmes les plus glauques et de l’appât du gain. Ce qui aurait pu rester une simple rumeur est aujourd’hui documenté: l’homme qui détient une part significative de la presse française et qui influence l’opinion publique a bâti sa fortune sur une industrie sordide.
Claudia Tavares, ex hôtesse du Minitel rose vient de publier son livre «La volonté d’exister» dans lequel elle dénonce les nombreux abus de celui qu’elle nomme son «proxénète». Elle se confie dans une enquête de Off Investigation. «Je ne suis pas une ancienne prostituée… j’étais une enfant à la rue jetée à la prostitution à l’âge de 14 ans. C’est différent», confie-t-elle. «Xavier Niel a utilisé ma bouche, mes seins, mon vagin et mon c.., mon corps, mon intelligence. Il m’a possédée Xavier Niel, corps et âme». Comme mentor d’une grande école, on peut faire mieux.
Comment expliquer que Xavier Niel continue de jouir d’une telle influence malgré son passé ? La réponse est simple : il contrôle une partie du système médiatique français. Co-actionnaire du groupe Le Monde, propriétaire de L’Obs et de nombreux médias en ligne, il influence massivement la narration publique.
Même le célèbre avocat français Juan Branco, Robin des Bois de la défense des pauvres, des persécutés et des minorités, ne ménage pas ses mots au sujet de Xavier Niel. Sur son compte Twitter, il écrit: «Il a fait de l’exploitation de la femme son fonds de commerce (…)». Il a d’ailleurs titré une vidéo «Pourquoi Xavier Niel et Bernard Arnault me dégoûtent».
En juin 2021, le journal Libération publie que «dans un rapport portant sur «l’accessibilité des images d’abus pédosexuels sur Internet», le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) indique avoir analysé 5,4 millions d’images d’abus pédosexuels, observées entre 2018 et 2020 parmi plus de 760 fournisseurs de services électroniques. Il constate que «près de la moitié des images détectées (48 %) sont liées à un service d’hébergement de fichiers exploité par Free», dont Xavier Niel est le véritable propriétaire, en détenant la majorité des parts d’Iliad. Face à ces accusations, Free a reconnu la nécessité d’améliorer ses systèmes de détection et de suppression de contenus illégaux. Céline von der Weid, la directrice de communication du groupe Iliad (dont fait partie Free), s’est justifiée en expliquant notamment que «pour ne pas entraver le travail des inspecteurs (ndlr : de la lutte contre la pédocriminalité), Free laissait des contenus illicites». Ben voyons!
En février 2025, lors d’une intervention dans l’émission «Les 4 vérités» sur Télématin, Xavier Niel a traité Elon Musk de «connard»… On pourrait s’attendre à un peu plus de courtoisie de la part de l’un des hommes les plus puissants de France, investisseur de taille dans les hautes écoles formant les leaders du futur.

Bernard Arnault, lui, est souvent cité comme l’un des hommes les plus riches du monde, architecte de l’empire LVMH. Il n’a jamais été condamné, mais son nom apparaît régulièrement dans des enquêtes sur des montages fiscaux opaques, des transactions douteuses et des pratiques d’optimisation fiscale à la lisière de la légalité. Cette réalité, pourtant bien documentée, est soigneusement occultée lorsque l’on présente l’homme comme un « visionnaire », un modèle de leadership pour les jeunes générations.
Rodolphe Saadé, magnat du transport maritime et PDG de CMA CGM, est mis en avant comme un capitaine d’industrie exemplaire. Pourtant, en 2020, son entreprise est condamnée à une amende de 4 millions de dollars aux États-Unis pour violation des sanctions contre l’Iran, la Syrie et le Soudan. En 2024, Mediapart révèle qu’il utilise une niche fiscale qui lui permet d’échapper à l’impôt en France, alors que sa fortune explose grâce à la crise du Covid-19. Le journal titre : «Le milliardaire chouchou de Macron, échappe à l’impôt». Son influence sur les médias est telle qu’il a ordonné la mise à pied du directeur de la rédaction de La Provence (qu’il avait racheté en 2020) après une critique sur une visite d’Emmanuel Macron à Marseille.
Ariane de Rothschild, à la tête du groupe bancaire Edmond de Rothschild, est présentée comme une femme de pouvoir inspirante. Elle a été impliquée dans plusieurs affaires judiciaires et controverses au cours de sa carrière. En 2023, une enquête du Wall Street Journal a révélé qu’Ariane de Rothschild avait eu des contacts d’affaires avec Jeffrey Epstein, l’homme d’affaires qui dirigeait un réseau international de chantage pédocriminel impliquant des personnalités haut placées. Malgré des démentis initiaux, il a été rapporté qu’elle avait rencontré Epstein à plusieurs reprises entre 2013 et 2019 et l’avait aidé à rechercher des assistants.
Son groupe a également été cité dans le scandale des Panama Papers en 2016 pour avoir facilité l’évasion fiscale de certains de ses clients. En 2021, une perquisition a lieu dans les locaux suisses de sa banque, alimentant des soupçons de fraude fiscale de grande ampleur.
Christophe Bancel, PDG de l’entreprise Tissium, une entreprise de technologie médicale, n’a pas de cadavres au placard, sinon qu’il est le frère de Stéphane Bancel, le PDG de Moderna qui a vacciné la planète contre le Covid. Même si leurs carrières semblent avoir suivi des trajectoires parallèles mais indépendantes, Stéphane a rendu hommage à son frère dans une interview au journal Le Soir en 2020, soulignant l’engagement de Christophe dans la lutte contre la « pandémie » avec Moderna.
Pour rappel, Moderna, comme d’autres fabricants d’injections contre la Covid-19, fait l’objet de nombreuses plaintes pénales concernant les effets secondaires de son vaccin, notamment comme des myocardites et péricardites, des réactions allergiques graves, des thromboses et troubles de la coagulation. Les résultats de ces litiges varient en fonction des juridictions et des circonstances spécifiques de chaque cas. Même si cette filiation ne fait pas de Christophe Bancel un partenaire financier infréquentable, sa présence parmi la liste des partenaires financiers permet de comprendre pourquoi l’Albert School, laboratoire du business et de la data appliquée à l’e-santé, semble taillée sur mesure pour alimenter les industries et continuer à faire la fortune de ses investisseurs.
Marc Simoncini, fondateur du site de rencontres Meetic, est aussi présenté comme un modèle de réussite entrepreneuriale. Pourtant, le fondateur des sites d’optique en ligne Sensee et Lentillesmoinscheres a été débouté et condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts dans une procédure de diffamation intentée contre Optic-Libre, marquant l’abandon de son ambition dans l’optique, preuve que ses démêlés judiciaires et commerciaux n’ont pas abouti au succès escompté.
La voie de l’intégrité
Face à cette accumulation de faits, et de réputations controversées, l’Albert School, loin de refléter une vision du leadership fondée sur la probité et la responsabilité sociale, semble plutôt enseigner aux étudiants une logique d’ascension où la fin justifie les moyens.
L’éducation, pour être un réel vecteur de progrès humain, ne peut se limiter à un tremplin vers la fortune. La véritable crédibilité d’une institution ne devrait pas reposer sur la richesse de ses investisseurs, mais sur leur intégrité et leur capacité à incarner des valeurs éthiques, si possible. D’ailleurs, il est difficile de trouver un multimilliardaire ayant investi dans l’éducation et dont le parcours est totalement irréprochable, tant l’accumulation extrême de richesses s’accompagne souvent d’une concentration de pouvoir et de corruption.
Cependant, parmi les figures les plus citées pour leur engagement philanthropique dans l’éducation et leur intégrité relative, on peut évoquer Chuck Feeney.
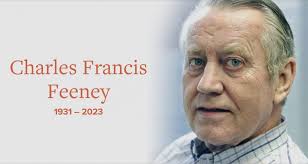 Chuck Feeney, le milliardaire qui a tout donné
Chuck Feeney, le milliardaire qui a tout donné
Chuck Feeney, cofondateur de Duty Free Shoppers, restera dans l’histoire comme l’un des philanthropes les plus discrets et les plus généreux du XXe siècle. Contrairement à la plupart des grandes fortunes, cet Américain d’origine irlandaise n’a pas attendu sa mort pour redistribuer son immense richesse. Pendant des décennies, il a donné toute sa fortune, soit huit milliards de dollars, à des causes humanitaires et éducatives, et ce, dans l’anonymat le plus total.
Précurseur du concept du « Giving While Living », il estimait que la fortune devait être utilisée pour améliorer la vie des autres plutôt que d’être accumulée inutilement. À travers sa fondation « Atlantic Philanthropies », il a financé des hôpitaux, des universités et des programmes de recherche médicale aux États-Unis, en Irlande, en Afrique du Sud et au Vietnam. Parmi ses contributions les plus marquantes figure le financement d’établissements prestigieux comme Cornell, Stanford ou Trinity College Dublin.
Pourtant, l’homme refusait tout signe extérieur de richesse. Alors qu’il aurait pu vivre dans le luxe, il habitait un modeste appartement loué, voyageait en classe économique et portait une simple montre à quinze dollars. Il ne possédait ni voiture, ni maison et s’est toujours tenu éloigné des projecteurs. Ce mode de vie austère contrastait avec l’ampleur de son impact philanthropique.
Feeney a fermé sa fondation après avoir atteint son objectif : donner jusqu’au dernier centime. Il a prouvé qu’un milliardaire pouvait changer le monde sans jamais chercher la reconnaissance.
Dans un monde où la philanthropie des milliardaires est souvent entachée de conflits d’intérêts et de stratégies d’influence, Feeney reste une exception. Toutefois, il est important de rappeler qu’aucune figure, même philanthrope, n’échappe à la critique et que l’éducation publique indépendante reste le meilleur rempart contre les dérives du capitalisme éducatif, souvent incarné par des personnalités dont l’éthique n’est pas une priorité.
Le formatage des étudiants: une éducation sous influence
Outre le décalage que nous venons de décrire entre richesse et vertu, nous devons aussi nous questionner sur certains partenariats entre universités, hautes écoles et entreprises, dont l’influence a considérablement augmenté ces dernières années. Un article de «Forbes» intitulé «How Big Pharma and Big Tech Are Shaping the Future of Education» explore comment ces partenariats façonnent les programmes éducatifs. Les entreprises financent des écoles telles que l’Albert School, des chaires universitaires, des programmes de recherche et même des cursus entiers, orientant ainsi l’enseignement vers des compétences directement utiles à leur industrie. Plus positivement, les étudiants bénéficient de partenariats avec des entreprises telles que LVMH, Carrefour et BCG Gamma, leur offrant ainsi des opportunités professionnelles variées.
Pourtant, «The Chronicle of Higher Education», dans un rapport intitulé «The Corporate Takeover of Higher Education», critique cette marchandisation de l’éducation. Les universités, autrefois considérées comme des bastions de la connaissance et de la pensée critique, sont de plus en plus perçues comme des usines à produire des travailleurs pour le marché. Les cursus sont conçus pour répondre aux besoins des entreprises, au détriment d’une éducation plus large et plus critique. On ne forme plus de grands esprits, mais on formate des étudiants pour le marché du travail, le plus souvent à leur insu.
 Étudiants, réappropriez-vous votre avenir par l’indépendance et la créativité
Étudiants, réappropriez-vous votre avenir par l’indépendance et la créativité
Les étudiants doivent se poser une question essentielle : comment choisir une école porteuse de valeurs qui permette de développer une pensée critique et indépendante, tout en trouvant une place dans le monde économique actuel ?
Comment préserver leur liberté individuelle et leurs idéaux dans un travail qui les passionne ?
Enfin, comment peuvent-ils nourrir leur âme par une élévation dans leur programme pédagogique et, pour les plus rares d’entre eux, rester un être souverain au service du bien commun ? Où, pour paraphraser Jean Jaurès, « les actes de leurs enseignants ou de leurs bailleurs de fonds enseignent mieux que les discours… » ?
Il appartient aux étudiants de questionner leur rôle dans ce système qui les instrumentalise volontiers et de s’assurer que leur intelligence et leur créativité servent un vrai déploiement collectif par l’inspiration.
Comme l’avait élégamment déclaré Albert Schweitzer, Prix Nobel de la paix en 1952: «L’exemplarité n’est pas une façon d’éduquer, c’est la seule».
Pensez à vous abonner ou à faire un don.