JD Vance: du plaidoyer politique au miroir pour soi-même

Comment s’engager pour ses valeurs sans renforcer la division?
Le discours du vice-président des États-Unis, JD Vance, lors de la Conférence de sécurité de Munich, a suscité l’enthousiasme ou l’aversion, si l’on s’en tient à une analyse purement dualiste de l’actualité. Avec Essentiel News, comme son nom l’indique, nous aimons aller à l’essentiel, y compris dans l’actualité! Et si, plutôt que de prendre position pour un camp ou l’autre, nous apprenions à faire d’un discours politique un miroir pour soi et un moyen de nous engager sur un chemin plus vrai?
Depuis le discours de JD Vance à la Conférence de sécurité de Munich, une fracture nette s’est creusée, dessinant deux visages de l’Occident qui se toisent et se défient. Les algorithmes et les réseaux sociaux ont amplifié la polarisation émotionnelle autour des propos du vice-président. Cette hyperbole de commentaires jetés sur la toile tous azimuts, comme des grains de maïs aux pigeons, ne fait que rendre le dialogue encore plus stérile entre les camps. Cependant, avec un peu d’entraînement, le discours de Vance peut être un formidable tremplin pour soi-même.
Quand le discours se fait « maître »
En laissant opérer en soi un peu de mise à distance, en passant du mode « partisan » à celui d’«observateur», le discours du vice-président américain, comme tout discours politique d’ailleurs, peut devenir un « maître », en ce sens qu’il révèle notre carte topographique intérieure. Si nous nous sommes construits du côté droit du balancier, nous y mettons un filtre souverainiste, conservateur et populiste de droite. Le discours de JD Vance est vécu comme une défense courageuse des libertés fondamentales, en particulier la liberté d’expression et la souveraineté populaire, face à des dérives technocratiques et autoritaires en Europe. Nous apprécions l’importance d’écouter le peuple, de protéger l’identité nationale et de préserver la démocratie contre l’excès de censure et l’ingérence des élites.
Si nous nous sommes construits du côté gauche du balancier, nous nous revendiquons progressiste, centriste libéral, pro-européen et social-démocrate. Dans ce cas, le discours de JD Vance sera vu comme un appel à la défiance envers les institutions européennes, un plaidoyer populiste inquiétant, qui alimente les peurs sur l’immigration et la perte d’identité, tout en légitimant les partis d’extrême droite. Sous couvert de défendre la démocratie, JD Vance fragiliserait les institutions, saperait la lutte contre les discours de haine et témoignerait d’une ingérence américaine déguisée en leçon de morale.
 Ces visions incarnent deux conceptions opposées de la démocratie : l’une défend la primauté de la volonté populaire et la liberté d’expression comme absolue. L’autre, en exclusivité, voudrait valoriser l’État de droit, la protection des minorités et l’encadrement des dérives populistes pour préserver l’équilibre démocratique. Cette mécanique psychique qui tourne en boucle depuis des siècles nous emprisonne dans une opposition binaire, très bien illustrée dans l’énoncé de JD Vance, entre le «bien» et le «mal», entre «liberté» et «oppression», entre «peuple» et «élites». Et si nous pouvions faire mieux ? Est-il possible d’agir et de se positionner sans renforcer les divisions ? On appelle cela l’art de la non-dualité, une traduction du sanscrit «Advaïta» qui signifie «pas deux».
Ces visions incarnent deux conceptions opposées de la démocratie : l’une défend la primauté de la volonté populaire et la liberté d’expression comme absolue. L’autre, en exclusivité, voudrait valoriser l’État de droit, la protection des minorités et l’encadrement des dérives populistes pour préserver l’équilibre démocratique. Cette mécanique psychique qui tourne en boucle depuis des siècles nous emprisonne dans une opposition binaire, très bien illustrée dans l’énoncé de JD Vance, entre le «bien» et le «mal», entre «liberté» et «oppression», entre «peuple» et «élites». Et si nous pouvions faire mieux ? Est-il possible d’agir et de se positionner sans renforcer les divisions ? On appelle cela l’art de la non-dualité, une traduction du sanscrit «Advaïta» qui signifie «pas deux».
Cette approche n’a rien à voir avec la posture du « milieu », de «l’entre deux» qui relève plus de la complaisance, de la peur du conflit et de l’indécision chronique. Une société où l’on évite les désaccords par crainte de heurter les sensibilités devient vulnérable à la manipulation, à l’abus de pouvoir et à la superficialité jusqu’à se scléroser dans l’immobilisme. Une lecture non dualiste des propos de Vance, dans l’esprit de l’Advaita Vedanta, du taoïsme et du bouddhisme zen, invite à voir au-delà des polarités apparentes, en reconnaissant que ces oppositions sont souvent le fruit de l’esprit humain qui segmente la réalité pour tenter de la contrôler. Diviser le monde en catégories donne l’illusion de maîtriser ce qui, en réalité, nous échappe.
Dissolution de l’ennemi intérieur et extérieur
Alors amusons-nous à décoder le discours de JD Vance à la lumière de la non-dualité. Pour commencer, son plaidoyer révèle l’attachement humain aux certitudes, aux frontières et aux identités. Par exemple, JD Vance oppose de façon marquée un «nous» (les démocraties, les citoyens opprimés) et un «eux» (les élites, les censeurs, les migrants menaçants, voire la Russie ou la Chine en arrière-plan). Cette logique de confrontation repose sur un paradigme dualiste : la sécurité contre la menace, le peuple contre les dirigeants, la liberté contre la censure. La non-dualité invite à dépasser ces oppositions en reconnaissant que la sécurité et la liberté véritables naissent d’un apaisement intérieur, et non de la victoire d’un camp sur l’autre. « Et, parmi tous les défis urgents auxquels les nations ici représentées font face, je ne crois pas qu’il y en ait de plus pressant que les migrations de masse », a déclaré le vice-président. Or, la non-dualité enseigne que cette division est illusoire. L’autre n’est jamais qu’un reflet d’une part de nous-même. En dénonçant avec véhémence un ennemi, on risque d’alimenter ce même cycle de violence et de fermeture. Ce que l’on combat à l’extérieur prend souvent racine en nous. Le sage non-duel dirait : «Où est l’ennemi si ce n’est dans ta propre peur ?»
Dans cette optique, la vraie sécurité ne vient pas d’une victoire sur l’autre, mais d’un dépassement de la peur et d’une reconnaissance que les conflits extérieurs reflètent nos luttes intérieures. Cela conduit à la paix, non pas par la confrontation, mais par la dissolution des identifications.
JD Vance célèbre la liberté d’expression et la souveraineté populaire comme des garanties essentielles à la démocratie. Ces libertés sont vues comme extérieures : pouvoir dire, pouvoir voter, pouvoir décider. Or, la non-dualité réoriente cette notion de liberté : « la seule liberté réelle est celle qui s’affranchit de l’identification au mental et aux désirs », racontent les textes anciens. La parole peut être libre extérieurement, mais si elle est motivée par la peur, l’ego, le besoin de dominer ou d’avoir raison, elle reste une prison intérieure. Parlons-nous librement ou sommes-nous l’esclave de nos opinions ? Dans ce cadre, le combat pour la liberté d’expression est nécessaire mais incomplet s’il n’est pas accompagné d’un travail intérieur pour libérer l’individu de ses propres conditionnements. Ce n’est pas la censure extérieure qui est le plus grand danger, mais l’auto-aliénation par la peur et la colère.
JD Vance valorise le «peuple» face aux «élites» déconnectées. Cette rhétorique crée une scission nette entre deux camps. La non-dualité considère que ces catégories sont des constructions mentales. Le peuple et les élites font partie d’un même tout interdépendant. Les élites naissent du peuple et le peuple est en partie façonné par ces élites.
La distinction entre gouvernants et gouvernés est une forme de projection mentale qui empêche de voir que chaque individu, quel que soit son statut, est mû par les mêmes peurs, les mêmes besoins d’amour et de reconnaissance. «Quand tu dis «eux», qui sépares-tu de toi-même ?» Dépasser cette division signifie reconnaître que les élites sont aussi humaines, traversées par leurs failles, et que le peuple, souvent idéalisé, n’est pas exempt d’aveuglements. Ce constat s’est vérifié avec la docilité des peuples pendant les années Covid, leur adhésion hypnotique à la diabolisation du CO2, leur soumission aux injonctions mensongères de la presse conventionnelle. La vraie démocratie, dans une perspective non duelle, est celle qui naît de la reconnaissance que nous sommes tous «cela» : citoyens et dirigeants, puissants et faibles. À ne surtout pas confondre avec le « nous sommes tous UN » et sa mortelle uniformisation des idées.
Le piège de l’attachement aux opinions
JD Vance défend la pluralité des voix, mais son discours est lui-même porteur d’une vérité revendiquée comme supérieure : la sienne, celle des « vrais peuples ». Une affirmation qui nous fait penser à la célèbre phrase du président George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001, «Either you are with us, or you are with the terrorists.» Cette posture dogmatique enferme l’orateur dans l’attachement à ses opinions et son public dans l’obligation de choisir son camp.
La non-dualité rappelle que « toute opinion est transitoire, limitée, et qu’y adhérer de manière rigide est une nouvelle forme d’esclavage. » Le sage taoïste dirait : «Ni ta parole ni celle de l’autre ne sont la vérité. La vérité est ce qui reste quand tu lâches l’attachement à avoir raison.» Dans cette optique, défendre la liberté d’expression est fondamental, mais ce combat doit être accompagné d’un dépouillement intérieur : apprendre à écouter vraiment, sans se cramponner à son point de vue. Cela suppose d’accepter que les voix qui nous dérangent peuvent elles aussi contenir une part de vérité.
La peur de l’effondrement est une illusion
JD Vance joue sur une crainte sous-jacente : celle d’une civilisation occidentale menacée, d’un ordre social prêt à s’effondrer sous l’effet de l’immigration, des élites déconnectées ou de la censure. Ce récit anxiogène est puissant car il s’adresse à notre instinct de survie.
La non-dualité invite à reconnaître que « l’impermanence est la nature même de toute chose. » Les civilisations naissent et meurent. Vouloir préserver à tout prix un ordre ancien est une lutte contre l’inévitable. Cela ne signifie pas l’inaction, mais une action détachée de la peur. La sagesse consisterait à accueillir le changement comme un flux naturel, sans crispation. «Ce que tu veux protéger est déjà en train de se transformer. Résister ou accompagner ?»
Ainsi, le prisme non duel inviterait non pas à réfuter ou adhérer au discours de JD Vance, mais à l’entendre comme l’expression d’une peur universelle : la peur de perdre ce que nous croyons être. La réponse ne serait ni de le combattre ni de l’applaudir, mais de le reconnaître en nous-mêmes – et d’agir depuis un espace intérieur libre de cette peur. À la place, la confiance en soi s’est installée, permettant du même coup de sortir d’une forme d’espoir projetée sur une figure, qu’elle soit Trump ou Musk.
Frapper d’une main non dualiste, c’est possible ?
Pourtant, au-delà d’un aspect polarisant dans le discours de JD Vance, on peut aussi lui octroyer de grandes qualités, propres aux sages. Nous pouvons apprécier ce ton inhabituel et rafraîchissant dans la politique internationale. JD Vance frappe d’abord par la clarté de sa parole, dénuée des circonvolutions et des prudences souvent propres aux responsables politiques. Son ton direct et son choix d’exemples concrets donnent à son propos une impression de transparence, comme s’il levait le voile sur des réalités que d’autres préfèrent taire. Cette franchise est portée par une sincérité palpable, notamment dans son appel au respect de la liberté d’expression comme un dogme sacré : il ne cherche pas à plaire, mais à dire ce qu’il estime juste, quitte à déranger.
Enfin, au-delà des clivages, il affiche une ouverture réjouissante, affirmant que l’écoute des voix dissonantes, y compris celles des populistes ou des opposants, est essentielle à la vitalité démocratique. Enfin, il a dénoncé ce qu’il perçoit comme une hypocrisie : d’un côté, l’Europe se présente comme le bastion des libertés, mais de l’autre, elle pratique la censure, interdit certaines voix politiques et va jusqu’à annuler des élections, comme en Roumanie. En soulignant ces contradictions, Vance a sous-entendu que les Européens avaient trahi leurs propres principes, leur rappelant que la démocratie ne se défend pas en muselant le peuple, mais en lui faisant confiance. Une déculottée pour les dirigeants de l’Union européenne vécue par beaucoup comme une vraie bouffée d’oxygène !
Sur la trace des sages conquérants
Cette posture, entre affirmation et sagesse, rappelle d’autres leaders à travers l’histoire qui avaient compris que la paix véritable et la stabilité durable ne s’obtiennent pas par la victoire d’un camp sur un autre, mais par l’intégration des différences, la transformation intérieure et par l’engagement dans l’action. Ces chefs d’État et diplomates, ces philosophes d’action, ont su pressentir que gouverner ne consistait pas seulement à vaincre, mais à rassembler. Leur puissance ne s’est pas nourrie de l’écrasement de l’autre, mais de l’art de tenir ensemble les forces contraires. Prenons quelques exemples : Marc Aurèle, empereur-philosophe de Rome, guerrier d’exception, n’a pas cherché la paix sur les champs de bataille, mais en lui-même. Alors que les frontières de l’empire étaient sans cesse menacées, il consignait dans ses carnets stoïciens cette vérité simple : le seul empire durable est celui que l’on bâtit sur ses propres tourments. Gouverner, c’était se soumettre à l’ordre du monde, en gardant la tempête au-dehors sans la laisser gagner son cœur.
Mentionnons également le penseur et écrivain Baruch Spinoza (1632-1677) qui a consacré sa vie à l’étude et à la méditation philosophique sur la joie et la paix. Elle n’a pas été exempte d’actes concrets marquant son refus de la soumission aux dogmes et son attachement à la liberté. Très jeune, il fit preuve d’un courage rare en rompant avec sa communauté juive d’Amsterdam. Excommunié en 1656 pour ses idées jugées hérétiques, il choisit l’exil intérieur plutôt que la rétractation, affirmant ainsi que la fidélité à la pensée libre valait plus que l’appartenance collective. Ce même souci d’indépendance le guida lorsqu’il refusa une chaire universitaire prestigieuse, préférant mener une vie simple de polisseur de lentilles afin de préserver son autonomie intellectuelle. Mais Spinoza ne se contenta pas de préserver sa liberté, il la défendit pour tous. Dans son Traité théologico-politique (1670), il plaida pour la liberté d’expression et la tolérance religieuse, en affirmant que l’État devait garantir à chacun le droit de penser et de s’exprimer sans crainte. Ainsi, loin d’être seulement un penseur retiré, Spinoza fut aussi, par ses choix de vie et ses écrits, un artisan de la liberté, œuvrant à l’émancipation de l’individu face aux emprises spirituelles et politiques.

À des milliers de kilomètres, dans les couloirs feutrés des Nations Unies, Dag Hammarskjöld (1905 – 1961) servait une cause plus discrète, mais tout aussi essentielle. Ce Suédois, féru de mysticisme, croyait que l’impartialité n’était pas une faiblesse, mais la clé de la paix. Hammarskjöld fut un homme d’actions concrètes, engagé sur les terrains les plus brûlants de la guerre froide et des conflits postcoloniaux. Face aux tensions de Suez en 1956, il joua un rôle clé pour éviter l’escalade, en déployant la première force d’interposition des Casques bleus. Il s’imposa comme un médiateur impartial, désamorçant des crises avec patience et fermeté.
Lors de la crise congolaise en 1960, il tenta d’éviter l’effondrement du pays après l’indépendance, engageant l’ONU dans une opération complexe de maintien de l’ordre, malgré les pressions des grandes puissances. Le diplomate suédois voulait un peu trop la paix et l’a payé de sa vie. C’est dans sa mission au Congo qu’il trouva la mort, son avion s’écrasant dans des circonstances troubles alors qu’il se rendait au Katanga pour négocier un cessez-le-feu. Sa disparition scella son image d’homme d’État habité par une éthique supérieure, refusant les compromissions politiques et plaçant la paix au-dessus des intérêts nationaux. Hammarskjöld incarne ainsi une figure rare : celle d’un dirigeant pour qui le pouvoir n’était pas une fin en soi, mais le prolongement naturel d’une discipline intérieure. Sa sagesse éclairait son action, et son action donnait corps à sa quête d’un monde plus juste.
De la sagesse des légendes
Il faut encore descendre au cœur des épopées pour trouver, en Inde, une autre figure qui porte cette sagesse mêlée au combat : Arjuna, l’archer légendaire du Mahabharata. Guerrier d’élite, invincible sur le champ de bataille, Arjuna est pourtant resté dans l’histoire moins pour sa force que pour le dilemme intérieur qui l’a traversé, au seuil d’une guerre fratricide. Sur la plaine de Kurukshetra, alors que les armées s’apprêtent à s’affronter, Arjuna vacille. Face à lui, il voit ses cousins, ses maîtres, ses amis. Comment tuer ceux qu’il aime ? Comment la victoire pourrait-elle avoir un sens si elle se bâtit sur le cadavre des siens ? À cet instant, le temps suspend son cours, et c’est là que se déploie la «Bhagavad-Gita», ce dialogue entre le guerrier et Krishna, son cocher divin.
Arjuna apprend que le véritable combat ne se situe pas contre l’autre, mais en soi. Krishna l’invite à dépasser la vision dualiste du bien et du mal, de la vie et de la mort. Il lui enseigne que l’action est inévitable, mais que sa pureté réside dans le détachement. Combattre, oui, mais sans haine, sans désir de victoire, sans s’identifier aux fruits de ses actes. Agir pour l’équilibre du monde, sans que l’ego ne s’en empare. Arjuna devient alors l’incarnation de cette non-dualité en action : le guerrier qui frappe, mais dont le cœur est en paix. Il tire ses flèches non par vengeance, mais parce que l’ordre cosmique l’exige. Il accepte que la vie et la mort soient les deux faces d’un même mouvement, et que son rôle est d’y participer, sans s’y perdre.

Son excellence martiale ne s’oppose pas à sa sagesse. Elle en devient l’expression. L’arme, dans sa main, n’est plus l’outil de la destruction, mais celui de l’harmonie. Arjuna incarne ainsi l’un des idéaux les plus élevés de la non-dualité : l’homme d’action qui agit sans s’attacher, le guerrier qui voit l’ennemi comme lui-même, et qui, en frappant, ne détruit pas, mais rétablit l’équilibre. C’est pourquoi, encore aujourd’hui, Arjuna n’est pas seulement vu comme un héros, mais comme l’archétype du juste équilibre entre force et conscience, entre action et renoncement.
Voilà bien le défi auquel font face les nombreux représentants de la dissidence dans le monde, marquée par une profonde méfiance envers les gouvernements, les institutions et les médias. Comment trouver ce juste milieu entre dénoncer des politiques de santé abusives, des élections truquées, la restriction des libertés individuelles et le transhumanisme, tout en respectant la diversité des opinions et du libre-arbitre de chacun ? L’exemple donné par ces conquérants de l’histoire, qu’ils soient sur le champ de bataille ou sur une tribune politique, peut offrir un élément de réponse.
Changer le monde devant sa porte
Adopter un regard désenclavé sur l’actualité est déjà un signe de sagesse intérieure qui révèle une certaine « respiration de l’âme ». Se détacher des remous émotionnels générés par les affaires du monde tout en se positionnant clairement et fermement pour nos valeurs, qu’elles soient progressistes ou souverainistes, permet de jouer avec la vie au lieu de la subir et de se prendre trop au sérieux.
Poser des petits ou de grands actes concrets au quotidien, engagés et sincères, génère ce précieux combustible pour renouveler le sens donné à notre existence. Une fois admis que, de tout temps, la vie politique n’est que palabres et gesticulations, rapprochements et confrontations, nous sommes libres de construire notre réalité, non plus à partir de nos perceptions, mais de ce qui nous rend éminemment vivants. Non plus à partir des girouettes dans le monde extérieur, mais en consultant notre boussole intérieure. Nous comprenons alors que nous pouvons utiliser ces forces évolutives et involutives à nous libérer de la domination des forces psychiques, mentales et sociales qui conditionnent l’homme contre lui-même. Grâce à ces rivalités apparentes, nous pouvons accéder à une autonomie de pensée, connectée à notre propre intelligence créative originelle.
Pensez à vous abonner ou à faire un don.
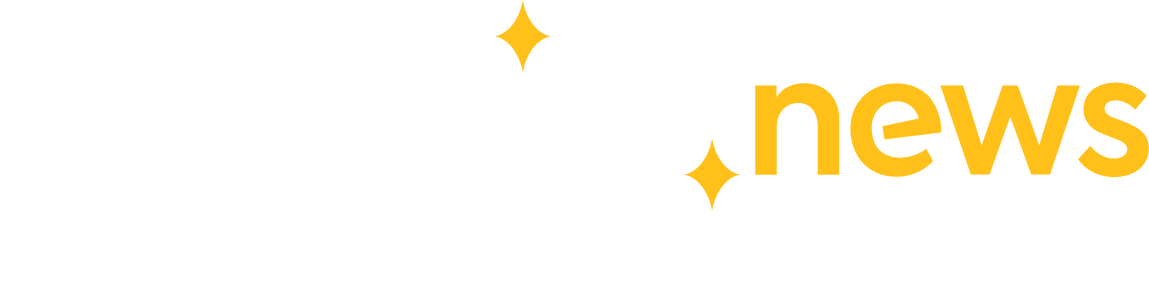
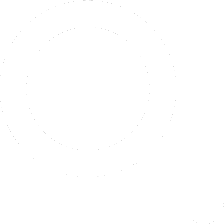
Quelle profonde réflexion qui rejoint l’approche de Jung nous invitant à faire notre travail pour intégrer notre part d’ombre. Sans l’ombre d’un doute, un message d’une puissante sagesse. La connaissance sans action n’est que de l’information qui attend l’action d’un être intégré pour se mettre au monde. La puissance de l’individuation est la clé d’une vie pleinement vécue au service de la vie et de la société. L’intégration commence par le travail sur soi ou on apprivoise notre part d’ombre afin d’en canaliser la force et d’éviter de la projeter sur le monde pour mieux la combattre comme si elle ne faisait pas partie de soi.
Merci infiniment d’avoir pris la peine de commenter et d’apprécier mon article. Vous avez parfaitement perçu que derrière cette analyse, il y avait le lent et patient labourage d’une vie. Chaleureusement, Isabelle